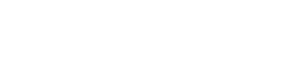Soutien vital ou premiers secours pour l’USAID ?
Dans cette analyse, Rébar Jaff examine l'évolution de l'engagement des États-Unis en Afrique sous l'administration Trump. Il met en lumière le passage d'une aide traditionnelle à des partenariats économiques axés sur des secteurs stratégiques, tout en discutant des avantages et des inconvénients de cette approche pour le développement du continent.

Par Rébat Jaff *

Sous l’administration Trump, il y a déjà eu un changement notable dans l’engagement des États-Unis vis-à-vis du monde, en particulier dans la manière dont les États-Unis allouent l’aide étrangère et abordent les stratégies de développement. Alors que certains analystes s’attendaient à une réduction significative du financement américain pour le continent, d’autres suggéraient que l’approche de l’administration pourrait être vue comme un pivot stratégique plutôt qu’un retrait complet.
Changement de paradigmes dans les relations USA-Afrique
Un élément clé de la politique étrangère de l’administration Trump a été l’approche « America First », qui met l’accent sur les intérêts nationaux, la sécurité et la prospérité économique. Cette politique a redéfini les relations des États-Unis avec le monde, avec un passage des programmes d’aide traditionnels à un accent mis sur les partenariats commerciaux et commerciaux.
Dans ce nouveau modèle, l’administration Trump considère les investissements commerciaux comme plus efficaces que l’aide traditionnelle pour promouvoir une croissance et une stabilité durables. Trump soutient que ce changement reflète une tendance mondiale plus large, où la collaboration économique, plutôt que la dépendance à l’aide, est priorisée. Bien que cette transition puisse impliquer moins de projets et moins de financement pour des secteurs comme le changement climatique et l’égalité des sexes, il y aura un accent croissant sur les secteurs qui s’alignent plus étroitement avec les intérêts économiques des États-Unis.
Principaux domaines d’intérêt et partenariats stratégiques
Pour l’Afrique, l’administration Trump a identifié des pays et des secteurs spécifiques qui s’alignent avec les objectifs économiques des États-Unis. Certains d’entre eux incluent :
- Le Kenya et l’Éthiopie pour les textiles : Ces pays sont positionnés pour fournir des textiles à des prix compétitifs, bénéficiant d’infrastructures et d’une main-d’œuvre qualifiée.
- Le Ghana pour le cacao : Avec la demande croissante de cacao de haute qualité, le Ghana est un partenaire essentiel pour répondre aux besoins des États-Unis dans l’industrie du chocolat.
- La République Démocratique du Congo pour le cobalt : Les vastes réserves de cobalt de la RDC sont essentielles à la production de batteries et de biens de haute technologie, en faisant un élément clé des stratégies américaines pour sécuriser les minéraux essentiels.
Ces changements soulignent un accent mis sur les bénéfices économiques mutuels, s’éloignant de la dépendance à l’aide et se dirigeant vers des partenariats à long terme, orientés par l’économie.
Les affaires plutôt que l’aide : L’argument économique
L’administration Trump considère que l’approche axée sur les affaires a le potentiel de dépasser les modèles d’aide traditionnels. En favorisant l’investissement et la collaboration, les États-Unis affirment qu’ils créeront des partenariats durables qui favorisent l’innovation, la création d’emplois et le développement économique. Selon Trump, ce changement s’aligne également avec les objectifs de sécurité nationale, car une Afrique prospère et stable, alignée avec les intérêts américains, est moins susceptible de tomber sous l’influence de puissances rivales.
Un élément central de la politique américaine en Afrique sous l’administration Trump a été de contrer l’influence croissante de la Chine sur le continent. La Chine a établi une forte présence en Afrique grâce à des investissements dans les infrastructures, des partenariats de sécurité et des accords commerciaux. En réponse, les États-Unis cherchent à exploiter leur avantage concurrentiel dans le capitalisme de marché, affirmant offrir aux nations africaines une approche alternative basée sur les affaires et l’innovation.
Pour les dirigeants africains, le passage des États-Unis à un engagement axé sur les affaires nécessite une nouvelle réflexion et une capacité d’adaptation. Les gouvernements devront favoriser la collaboration économique à une plus grande échelle, s’éloignant de la dépendance à l’aide et se concentrant davantage sur des partenariats économiques mutuellement bénéfiques. Ceux qui réussiront à naviguer avec succès dans cette transition pourraient trouver de nouvelles opportunités de croissance et de développement.
Avantages et inconvénients de cette approche
Avantages pour le secteur des affaires :
- Investissement soutenu et création d’emplois : L’accent mis sur les investissements commerciaux offre le potentiel d’une croissance économique soutenue, de la création d’emplois et du développement industriel, notamment dans des secteurs comme les textiles, le cacao et les minéraux.
- Partenariats économiques à long terme : Les entreprises peuvent établir des relations à long terme avec les gouvernements et les industries africaines, créant ainsi un environnement économique plus stable.
- Innovation et développement des infrastructures : Les approches axées sur les affaires favorisent souvent l’innovation et le développement des infrastructures, au bénéfice des États-Unis et des nations africaines.
- Concurrence accrue : L’accent mis sur les approches basées sur le marché pourrait entraîner une concurrence accrue, favorisant l’innovation et l’efficacité dans les industries à travers l’Afrique.
Inconvénients pour le secteur des affaires :
- Risque de concentration sur les profits à court terme : Bien que les entreprises puissent rechercher des gains à long terme, il pourrait y avoir une tendance à privilégier les profits à court terme au détriment du développement durable, ce qui pourrait nuire à la croissance à long terme.
- Vulnérabilité aux fluctuations du marché : Les investissements commerciaux sont soumis aux fluctuations du marché, ce qui pourrait entraîner de l’instabilité dans les industries fortement dépendantes des investissements externes.
- Concentration limitée sur le développement social : Les investissements commerciaux pourraient ne pas accorder une priorité suffisante aux secteurs sociaux comme la santé, l’éducation et l’égalité des sexes, qui sont essentiels pour un développement global.
- Dépendance aux intérêts américains : Les pays qui s’associent aux États-Unis pourraient devenir plus dépendants des besoins économiques américains, ce qui pourrait limiter leur capacité à diversifier leurs économies.
Avantages pour le secteur de l’aide humanitaire :
- Réduction de la dépendance à l’aide : Un éloignement de la dépendance à l’aide pourrait encourager les pays africains à adopter des stratégies de développement plus durables et autonomes.
- Croissance économique et développement : L’engagement axé sur les affaires pourrait conduire à une plus grande croissance économique, ce qui pourrait indirectement contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration des conditions de vie
- Stabilité régionale accrue : Les économies prospères sont souvent plus stables et moins sujettes aux conflits, ce qui peut renforcer la sécurité générale de la région.
- Engagement plus large avec les marchés mondiaux : Les pays africains pourraient avoir un meilleur accès aux marchés mondiaux grâce à des partenariats commerciaux plutôt qu’à des relations axées sur l’aide.
Inconvénients pour le secteur de l’aide humanitaire :
- Réduction de l’accent sur les services sociaux : Avec moins d’accent mis sur l’aide traditionnelle, des secteurs cruciaux comme la santé, l’éducation et les services sociaux pourraient recevoir moins d’attention et de financement, exacerbant potentiellement les inégalités.
- Les populations vulnérables en risque : Certaines des populations les plus vulnérables pourraient ne pas bénéficier des investissements commerciaux et pourraient continuer à dépendre de l’aide pour leurs besoins de base.
- Risque de bénéfices inégaux : Les investissements commerciaux pourraient ne profiter qu’à certaines industries ou régions au sein des pays africains, entraînant un développement inégal et laissant certaines populations derrière.
- Impact sur les réseaux humanitaires mondiaux : Un rôle réduit pour les programmes humanitaires financés par les États-Unis pourrait mettre à mal les efforts mondiaux pour répondre aux crises et aux urgences, en particulier dans les régions nécessitant une aide immédiate.
Bien que le passage de l’aide étrangère à des partenariats axés sur les affaires soit ancré dans un désir sincère de favoriser un développement à long terme et de réduire la dépendance, une telle transition exige une planification minutieuse, délibérée et une approche progressive. La réorientation stratégique doit être soutenue par une vision globale qui privilégie l’inclusivité et l’équité, en veillant à ce que les populations les plus vulnérables ne soient pas marginalisées dans le processus. Cette évolution doit être accompagnée d’interventions ciblées pour fournir le soutien nécessaire à ceux qui pourraient avoir besoin de plus de temps et de ressources pour naviguer dans ce changement. Ce n’est qu’en maintenant un engagement ferme à aider ces groupes à réussir leur transition que nous pourrons garantir que les bénéfices de cette nouvelle stratégie soient répartis équitablement. Une transition réfléchie et bien dosée, où l’autosuffisance économique est recherchée sans abandonner les plus vulnérables, créera une base pour un développement véritablement durable et global qui profitera à tous les segments de la société, favorisant un avenir résilient et prospère à travers le continent.
*Rébar Jaff
Rébar Jaff est un expert en conception de programmes de développement durable, en analyse de politiques et en aide humanitaire. Il a occupé des postes au sein d’ONG, de l’OCDE à Paris, du Secrétariat de l’ONU à New York et de diverses agences de l’ONU au Moyen-Orient et dans les Caraïbes. Il a été secrétaire du Conseil consultatif du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, sur les questions de désarmement.