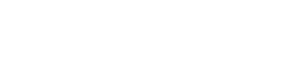Sommet numérique à Berlin : des promesses fortes, des avancées nuancées
Le 18 novembre 2025, un sommet européen sur la souveraineté numérique a rassemblé à Berlin plus de 900 décideurs. France et Allemagne ont annoncé des engagements ambitieux, mais les mesures concrètes soulèvent aussi des interrogations sur leur portée réelle et leur mise en œuvre.

Le Sommet sur la souveraineté numérique européenne, qui s’est tenu le 18 novembre 2025 à Berlin, marque un tournant dans la feuille de route technologique de l’Union européenne. Co-organisé par la France et l’Allemagne, l’événement a engagé des discussions ambitieuses autour de la régulation, des infrastructures numériques souveraines et de la protection des données stratégiques.
Mais au-delà du verbe fort et des intentions politiques, certaines annonces méritent d’être décryptées à la lumière de leurs limites et des risques d’un verdissement superficiel.
Les grands engagements… et leurs fragilités
Parmi les mesures les plus symboliques, la demande franco-allemande d’un moratoire de 12 mois sur les dispositions du règlement IA relatives aux systèmes “à haut risque” attire l’attention. L’idée est de créer un cadre réglementaire plus favorable à l’innovation, au prix d’un report de certaines obligations — un pari sur la flexibilité qui pourrait affaiblir la protection des citoyens. De même, la simplification du RGPD, réclamée par les deux nations, soulève le débat : alléger la paperasserie, oui, mais à quel coût en matière de garanties sur les données ?
Sur les marchés numériques, France et Allemagne encouragent la Commission européenne à lancer des enquêtes sur les hyper‑échelles cloud, ce que beaucoup jugent utile : aujourd’hui, une grande partie des données européennes reste hébergée sur des plateformes non-européennes. Mais l’enjeu est double : comment soutenir des solutions “made in Europe” sans aligner les règles sur celles des géants américains, sans y perdre en efficacité ou en coût ?
La souveraineté des données est un autre point central : les deux pays demandent des normes très strictes pour les données sensibles, notamment pour les protéger contre des législations extraterritoriales. Ce point vise à contrer la dépendance étrangère et à protéger la vie privée. Toutefois, certains experts alertent : des standards trop contraignants pourraient freiner l’innovation et l’interopérabilité au sein de l’UE.
Les infrastructures numériques : entre promesses et réalités
Paris et Berlin ont annoncé la création d’un consortium européen pour les “communs numériques”, avec l’Italie et les Pays-Bas, pour bâtir des infrastructures partagées. Cette initiative pourrait donner naissance à des alternatives plus souveraines aux géants du cloud, mais elle dépendra fortement des financements publics et de la capacité à mobiliser les acteurs européens dans la durée.
Ils se sont aussi engagés à promouvoir les outils open source dans l’administration, citant LaSuite / OpenDesk comme exemple. L’utilisation de logiciels libres permettrait de réduire la dépendance aux solutions propriétaires, mais soulève des questions sur le support technique, l’interopérabilité entre États et la capacité à maintenir ces systèmes à jour.
Par ailleurs, un groupe de travail franco-allemand sur la souveraineté numérique a été lancé. Il doit définir des “indicateurs de souveraineté” pour le cloud, l’IA ou la cybersécurité, et proposer des mesures concrètes. Les résultats sont attendus pour le Conseil des ministres franco-allemand de 2026. Ce cadre peut structurer la stratégie, mais son efficacité dépendra de la mise en œuvre concrète.
L’IA : levier d’innovation, mais terrain géopolitique
L’un des axes les plus ambitieux du sommet concerne l’intelligence artificielle d’avant-garde. France et Allemagne veulent encourager un “modèle européen d’IA”, combinant financements publics et partenariats privé-public. L’objectif : des technologies de rupture, mais compatibles avec les valeurs européennes.
Pour le chancelier Friedrich Merz, ce sommet est un moment clé : « Nous ne devons pas céder le champ numérique aux superpuissances », a-t-il averti, évoquant la concurrence croissante des États-Unis et de la Chine. Selon lui, l’avenir se joue dans la capacité de l’Europe à produire et réguler ses propres technologies plutôt qu’à en dépendre.
Le président français Emmanuel Macron partage cette vision, mais il met en garde : “La coopération transfrontalière n’est pas seulement une aspiration, mais un impératif stratégique.” Les annonces d’investissements de 12 milliards d’euros entre entreprises françaises et allemandes ont été saluées, mais certains analystes restent prudents : sans une vraie politique industrielle européenne, ces promesses pourraient rester symboliques.
Souveraineté à quel prix ?
Malgré les ambitions, le sommet suscite des critiques. Certains observateurs doutent que les investissements annoncés suffisent à rattraper le retard face aux géants du cloud. Le financement privé de l’IA et des centres de données européens sera clé, mais il pourrait aussi amplifier les inégalités entre grands groupes et petites start-up.
D’autres alertent sur les risques de dérégulation : simplifier les normes pour stimuler l’innovation peut creuser un fossé entre la protection des données et la flexibilité commerciale. Enfin, bâtir une souveraineté numérique européenne exige une coordination politique ambitieuse et des financements durables : sans cela, le sommet pourrait rester une déclaration de principe plus qu’un véritable tournant stratégique.
Vers une Europe numérique plus autonome…
Le Sommet de Berlin marque un pas important vers une Europe numérique plus autonome, mais il reste beaucoup à faire pour que ces ambitions se transforment en infrastructures concrètes et en technologies “européennes”.