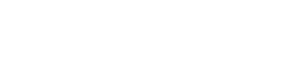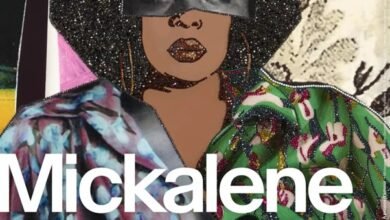Changer la vision du développement de l’Afrique : comment le Rwanda et l’Éthiopie ont tenté de façonner l’avenir
Le Rwanda et l’Éthiopie incarnent deux approches audacieuses du développement en Afrique. Entre infrastructures massives et visions modernisatrices, ces modèles interrogent les idées et croyances qui façonnent l’avenir du continent. Analyse.

Par Barnaby Joseph Dye et Biruk Terrefe*
Les défis économiques contemporains en Afrique semblent faire entrer le continent dans une nouvelle ère de développement. De la COVID-19 à l’inflation provoquée par la guerre, de nombreux pays africains sont confrontés à des défis économiques considérables. Les crises de ces dernières années s’ajoutent à des augmentations à long terme de la dette, en particulier après le choc des prix des matières premières de 2014 .
Ces circonstances ont servi de toile de fond aux conflits, coups d’État et changements de régime récents. Mais ces crises contemporaines font suite à une période de développement relativement réussi mené par l’État au cours des deux premières décennies du XXIe siècle, ce qui a donné lieu à un battage médiatique autour des nouveaux « lions africains » et à l’émergence d’un récit de « l’Afrique en plein essor ».
Deux cas se démarquent comme emblématiques de cette époque : la vision du Rwanda d’un centre financier et de services de type Dubaï, et les ambitions rapides de l’Éthiopie en matière de production industrielle et d’infrastructures.
On a beaucoup écrit sur les facteurs internationaux à l’origine de cette ère de développement dirigé par l’État. L’accent a été mis sur l’extension du financement privé et la croissance de « nouveaux » bailleurs de fonds comme la Chine, l’Inde et le Brésil. Mais ces perspectives négligent souvent des questions importantes. Qu’est-ce qui a inspiré les ambitieux plans nationaux africains au cours des deux dernières décennies ? Quelles hypothèses ont été formulées sur la manière dont le développement se produit et à quoi il devrait ressembler ?
Dans une nouvelle étude publiée dans un numéro spécial d’une revue, nous analysons ces visions modernisatrices. Nous démontrons leurs différences et leurs points communs à l’aide de cas provenant de plusieurs pays.
Nous mettons l’accent sur la compréhension des idées, des croyances et des normes dans l’élaboration des plans de développement. Ces perspectives sont souvent négligées dans l’étude de l’Afrique. Les chercheurs ont souvent présumé que les élites dirigeantes sont principalement intéressées par le pouvoir matériel ou l’enrichissement personnel. Nous soutenons que les idées et les croyances sous-tendent les objectifs et le contenu des plans de développement.
Les recherches couvertes dans le numéro spécial couvrent l’Angola , l’Érythrée et la Tanzanie , mais dans cet article nous allons décortiquer notre analyse de l’Éthiopie et du Rwanda .
Développement moderniste du 20e siècle
De nombreux éléments du développement de ce siècle ressemblent au « haut modernisme » du XXe siècle. Il s’agit d’un terme inventé par l’universitaire James Scott pour décrire les programmes de développement économique autoritaires, dirigés par l’État et dirigés par le haut. Ces programmes ont généralement utilisé les infrastructures et la technologie pour transformer des populations et des paysages prétendument « arriérés » et « traditionnels » en alternatives efficaces, modernes et rationnelles.
Les grands barrages en sont peut-être l’exemple le plus frappant. Historiquement, les barrages étaient considérés comme les projets phares de la modernisation. Ils pouvaient apprivoiser la nature et déployer des technologies, qu’il s’agisse d’électricité ou d’irrigation, pour créer des économies et des travailleurs modernes. Le barrage d’Akosombo au Ghana est l’un de ces projets.
Mais la construction de barrages a été interrompue du milieu des années 1990 au milieu des années 2000, lorsque la Banque mondiale et d’autres grands bailleurs de fonds se sont retirés. Les projets de barrages étaient considérés comme ayant des coûts sociaux et économiques trop élevés et n’étant pas très performants. Ces impacts négatifs ont également suscité d’importantes protestations.
Le cas du Rwanda
Le modèle rwandais repose sur une structure de pouvoir concentrée de style léniniste. Le président et les élites qui lui sont associées tracent la voie du progrès. Le parti, avec ses sociétés affiliées et ses fonds d’investissement, est tout puissant – pas seulement l’État. Le Rwanda a également relancé des projets du milieu du siècle, des barrages au corridor ferroviaire est-africain. L’électricité a été jugée centrale, ce qui a entraîné une multiplication rapide mais trop ambitieuse de la production par cinq en plus de 15 ans.
Cette période récente n’est pas seulement une reproduction des années 1960. Elle comporte des éléments nouveaux. Une esthétique de style Dubaï est au cœur de la capitale réinventée, Kigali, où l’objectif est de créer un nouveau pôle de services aux entreprises, rempli de gratte-ciel, de centres de conférence, de centres commerciaux et d’un nouvel aéroport international. Cela remplace l’obsession du 20e siècle pour les sites industriels et le béton brutaliste.
Au lieu des programmes étatiques du XXe siècle, des réformes en faveur du marché ont été adoptées. Le pays a adopté l’entreprise privée, la bourse et l’investissement. Le boom de l’électricité a été en grande partie le fait d’entreprises privées et le Rwanda se classe régulièrement parmi les premiers pays selon l’ indice de facilité de faire des affaires . Il faut des heures, et non des semaines, pour créer une entreprise et la bureaucratie réglementaire est rapide.
Dans certains cas, des réformes « néolibérales » ont été mises en place, avec des entreprises et des investissements privés dans des domaines auparavant contrôlés par l’État. Le Rwanda a adopté l’investissement et la propriété des entreprises tout en mettant en place des réformes favorables aux entreprises et à faible imposition . Le secteur privé s’est vu confier un rôle important dans l’essor du Rwanda, avec la construction de plus de 40 microcentrales hydroélectriques en 15 ans.
De nouvelles techniques de gestion publique, avec des incitations individuelles et des objectifs de fonction publique, ont été adoptées.
Le cas de l’Éthiopie
L’Éthiopie a concentré ses investissements sur de grandes plantations agricoles et des parcs industriels. Le résultat a rappelé les efforts de modernisation du XXe siècle. Un boom des infrastructures à grande échelle et une stratégie d’industrialisation qui a fait progresser les produits agricoles dans la chaîne de valeur ont transformé la structure de l’économie. Le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne , le chemin de fer Addis-Djibouti et d’autres mégaprojets sont devenus des symboles de cette vision. L’objectif était de maintenir le contrôle de l’État sur les secteurs clés de l’économie (électricité, eau, télécommunications et aviation, entre autres), tout en construisant une base industrielle qui absorberait le surplus de main-d’œuvre agricole.
Ces efforts ont été complétés par des investissements dans l’éducation et la santé. En 2016, l’Éthiopie affichait le troisième ratio le plus élevé d’investissement public par rapport au PIB, mais aussi l’un des taux de croissance économique les plus rapides au monde.
Contrairement au Rwanda, cette idéologie n’a pas survécu. Des progrès ont été réalisés en matière de santé, d’éducation et de revenus, mais les tensions politiques se sont accrues. Au milieu des années 2010, la réalité matérielle des moyens de subsistance de la population ne pouvait plus être à la hauteur des promesses évoquées par le parti au pouvoir. La dissidence n’était pas tolérée et a conduit à des manifestations de masse, des émeutes et à la disparition du parti. Depuis 2018, on assiste à un changement radical d’idéologie et de vision, avec une ouverture à la libéralisation et une focalisation sur le secteur des services plutôt que sur l’industrialisation .
Continuité et changement
Dans l’ensemble, notre analyse révèle une combinaison de continuité et de changement au cours de cette période. Elle marque le triomphe d’une « gauche africaine », avec de vieux titans comme le Chama Cha Mapinduzi de Tanzanie ou le Frelimo du Mozambique rejoints par de nouveaux partis révolutionnaires eux aussi inspirés par le marxisme.
Le langage du communisme ou du socialisme n’est pas utilisé explicitement. Mais la croyance selon laquelle les plans imposés par le haut et les méga-infrastructures peuvent propulser les gens vers un avenir « éclairé » perdure. Les barrières économiques structurelles sont surmontables grâce à la technologie et à l’ingénierie.
Dans le même temps, on ne peut échapper au discours des dirigeants de Davos sur la suprématie des marchés, l’importance des investissements étrangers et les engagements pris pour lutter contre le changement climatique et la pauvreté. Cela illustre à quel point ces modernisateurs illibéraux sont liés à l’élaboration des politiques internationales.
Notre publication conceptualise ce modèle de continuité et de changement sous la forme d’un manifeste en 10 points des « modernisateurs illibéraux ». Bien que présentant des variations considérables d’un pays à l’autre, nous soutenons que ces partis au pouvoir hégémoniques partagent des objectifs communs de transformation de la société par le biais d’un programme défini par les élites.
En fin de compte, le schéma de continuité et de changement démontre l’importance d’analyser les idées, les croyances et les valeurs. Les élites en Afrique, comme ailleurs, ne s’intéressent pas seulement au pouvoir, mais sont influencées par les idées sur le développement.
*Barnaby Joseph Dye est maître de conférences au King’s College de Londres et Biruk Terrefe est maître de conférences et chercheur postdoctoral à l’université de Bayreuth.
Source : https://democracyinafrica.org/