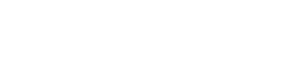Caroline Mbugua : « L’inclusion numérique est essentielle, nous devons nous assurer que tout le monde puisse participer à l’économie numérique de l’Afrique »
Alors que l’écosystème numérique de l’Afrique continue de se développer, les ambitions du continent vont bien au-delà de l’adoption de la technologie. De la connectivité mobile à l’inclusion numérique, l’Afrique façonne son propre agenda d’innovation. Avant le MWC Kigali 2025, nous avons échangé avec Caroline Mbugua, Directrice de la politique publique chez GSMA Africa, sur la connectivité, l’accessibilité, les politiques et le rôle de la collaboration dans la transformation numérique de l’Afrique.

Propos recueillis par Dounia Ben Mohamed
Comment évalueriez-vous l’état actuel de l’écosystème numérique africain, notamment en matière d’accès à Internet et de connectivité mobile ?
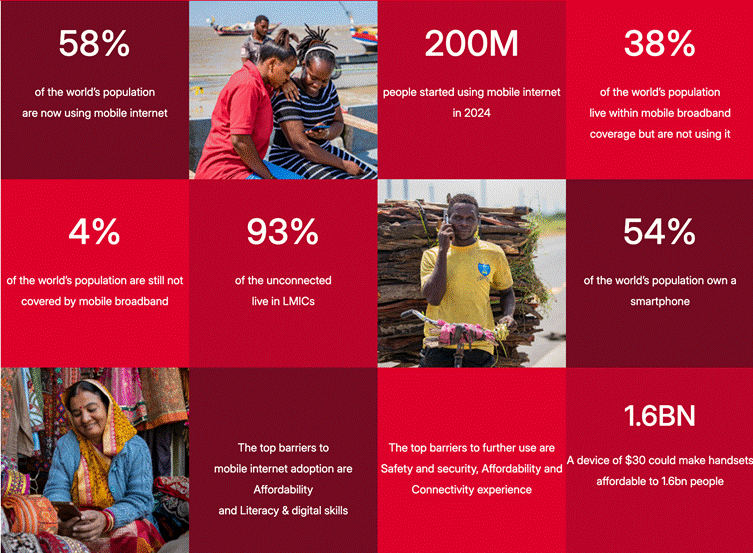
Si l’on se base sur les derniers rapports, et plus particulièrement sur le Mobile Internet Connectivity Report 2025, nous suivons trois principaux éléments : les utilisateurs connectés, le déficit d’usage et le déficit de couverture. Cela nous permet d’identifier clairement les lacunes.
Les utilisateurs connectés sont les consommateurs actifs sur les services de haut débit mobile (3G et plus). À l’échelle mondiale, 58 % de la population, soit 4,7 milliards de personnes, utilisent désormais Internet mobile sur leur propre appareil. En Afrique subsaharienne, environ 25 % de la population est connectée, soit près de 300 millions de personnes.
Le déficit d’usage reste significatif : 38 % à l’échelle mondiale (3,1 milliards de personnes) vivent dans une zone couverte mais n’utilisent pas Internet mobile. En Afrique subsaharienne, ce déficit d’usage est également d’environ 38 %, ce qui souligne la nécessité d’interventions ciblées de la part des décideurs politiques, des régulateurs et des acteurs industriels.
Le déficit de couverture — les personnes sans accès à la 3G ou plus — a diminué à 4 % au niveau mondial (300 millions de personnes) mais reste à 10 % en Afrique subsaharienne, soit environ 120 millions de personnes. Cela montre le besoin continu d’investissements pour que chacun puisse participer à l’économie numérique.
L’industrie mobile continue de stimuler la croissance économique, contribuant à environ 8 % du PIB de l’Afrique subsaharienne — près de 140 milliards USD en 2023 — et soutenant 4 millions d’emplois, avec un potentiel de génération de 280 milliards USD d’ici 2030 si les bonnes politiques sont mises en œuvre.
L’Indice Afrique Numérique, lancé en 2024, montre que des pays comme le Kenya, Maurice, les Seychelles et l’Afrique du Sud ont des scores de préparation numérique supérieurs à 50 %, mesurant la numérisation des consommateurs, des entreprises et des gouvernements. Cela met en évidence à la fois les progrès réalisés et le travail important restant à accomplir à travers l’Afrique.
Quels sont les principaux obstacles à l’adoption des technologies numériques dans les pays africains à faible revenu ?
Notre Mobile Internet Connectivity Report met en évidence les principales barrières contribuant au déficit d’usage. La première, et la plus critique en Afrique et en Afrique subsaharienne, est l’accessibilité des appareils et des services.
Par exemple, les appareils intelligents restent coûteux, ce qui entraîne une pénétration très faible des smartphones en Afrique, notamment dans les ménages à faible revenu, limitant l’accès aux services numériques. Or, les smartphones sont la porte d’entrée du monde numérique. Une solution est une réduction significative de la fiscalité, en particulier sur les appareils d’entrée de gamme. Un bon exemple est l’Afrique du Sud, où le gouvernement a supprimé la taxe dite de luxe sur les smartphones à 2 500 R ou moins, témoignant de son engagement à accélérer la transformation numérique et l’adoption des smartphones.
Un autre domaine critique est l’alphabétisation numérique. Elle est nécessaire pour que les utilisateurs comprennent comment naviguer dans le monde numérique et l’interpréter dans leurs langues locales ou de la manière qui leur convient le mieux. Les compétences limitées et le manque de sensibilisation freinent l’adoption, surtout dans les zones rurales et parmi les groupes vulnérables tels que les femmes, les jeunes et les communautés marginalisées. Des programmes très ciblés sont nécessaires pour développer l’alphabétisation numérique. Avec l’émergence de technologies comme l’IA, le défi devient encore plus important car l’alphabétisation numérique doit s’étendre de l’usage de base aux technologies avancées.
Nous observons également des défis liés au contenu — garantir que le contenu soit pertinent et disponible dans les langues locales, offrant aux consommateurs des raisons convaincantes de se connecter. Dans les zones rurales, les coûts élevés de déploiement des infrastructures, le coût de la vie et le faible pouvoir économique rendent les services encore plus coûteux. Des solutions telles que les fonds de service universel peuvent aider, mais doivent être plus efficaces. Dans notre rapport 2023, nous avons étudié des réformes politiques pour améliorer l’efficacité de ces fonds et assurer une meilleure utilisation pour stimuler la connectivité dans les zones rurales et sous-desservies.
Un autre domaine clé est la mise en œuvre des politiques. La volonté politique est essentielle pour combler ces lacunes, car l’adoption de politiques et de réformes réglementaires soutient la levée des barrières identifiées et stimule l’investissement continu sur le continent.
Comment les régulations locales impactent-elles l’investissement et l’innovation dans les secteurs des télécoms et du numérique en Afrique ?
Le point clé est la volonté politique. Il faut un environnement et des priorités adéquates pour promouvoir les politiques et réformes réglementaires qui soutiennent l’avancement du numérique et l’innovation en Afrique. Par exemple, l’incertitude réglementaire, avec des changements fréquents, crée de la peur et impacte négativement l’investissement. Assurer une certitude réglementaire est essentiel.
Cela inclut des périodes de licence plus longues, des redevances et frais de spectre raisonnables, des taxes sectorielles adaptées et des processus d’approbation simplifiés pour le déploiement des infrastructures. Des cadres de soutien tels que les bac à sable réglementaires et le partage d’infrastructures sont également très importants.
Les télécoms dépendent du spectre, leur ressource vitale. Garantir des politiques de gestion et des cadres réglementaires appropriés est crucial. La neutralité technologique, des conditions de licence claires et prévisibles, la disponibilité du spectre au bon moment, à un prix adéquat et dans les bonnes combinaisons sont essentiels.
GSMA collabore avec les régulateurs et décideurs pour harmoniser les politiques afin d’attirer et de retenir les investissements et garantir un environnement stable. Les réussites incluent la réforme du Universal Service Fund au Kenya, qui soutient désormais le CAPEX et l’OPEX pour le déploiement d’infrastructures ; la suppression des taxes sur les smartphones en Afrique du Sud ; le retour sur la hausse de la taxe d’accise au Kenya ; et la désignation des infrastructures télécoms comme infrastructures nationales critiques au Nigeria pour les protéger contre le vandalisme.
Ces exemples montrent des résultats politiques positifs, mais davantage d’interventions dans cette direction sont nécessaires.
Quel rôle joue GSMA dans la promotion de l’inclusion numérique et de l’accès mobile sur le continent ?
GSMA rassemble différents acteurs de l’écosystème numérique pour garantir la prospérité de la société et des entreprises.
Nous avons divers programmes, par exemple GSMA Mobile Connected Society, qui collabore avec les gouvernements, opérateurs et ONG pour étendre l’accès et l’adoption, en particulier dans les zones sous-desservies. Nous sommes également connus pour fournir des analyses basées sur les données à travers des rapports comme le Mobile Economy Report et des rapports de numérisation au niveau national.
Cela soutient les réformes politiques basées sur les données. Nous offrons aussi des plateformes comme MWC Kigali et d’autres événements pour favoriser le dialogue sur des enjeux critiques. GSMA est un catalyseur, réunissant les parties prenantes, fournissant des informations pour la prise de décision et encourageant l’apprentissage à partir de différents pays grâce aux indices. Enfin, nous plaidons pour des politiques qui améliorent la connectivité, l’accessibilité et l’innovation afin de réduire la fracture numérique.
Quels partenariats public-privé ont été les plus efficaces pour développer l’infrastructure numérique de l’Afrique ?
Un exemple clair est la collaboration entre l’industrie et les régulateurs nationaux pour garantir un spectre suffisant et un déploiement d’infrastructures clair. Par exemple, MTN Group a travaillé avec la Nigeria Communications Commission pour permettre le déploiement de la 5G au Nigeria, stimulant les services fintech et e-santé.
Nous avons également observé des modèles de partage d’infrastructure, comme Vodacom et Orange au Nigeria, et Airtel et d’autres opérateurs sur le continent, pour rendre le déploiement plus abordable et durable. La collaboration permet de combiner fonds publics et expertise privée pour une infrastructure numérique inclusive et scalable.
Comment les opérateurs mobiles peuvent-ils contribuer à la transformation économique et sociale de l’Afrique ?

Les opérateurs contribuent jusqu’à 8 % du PIB de l’Afrique subsaharienne, et jusqu’à 13,5 % au Nigeria. L’industrie mobile est un moteur clé de croissance économique.
Des plateformes comme M-Pesa, Airtel Money, MoMo et Orange Money favorisent l’inclusion financière en réduisant les coûts de transaction et en soutenant les PME dans les communautés informelles. Les opérateurs permettent également des services dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’agritech — comme MTBA au Kenya par Safaricom.
Les partenariats avec les gouvernements et ONG délivrent des services comme des alertes santé par SMS et des systèmes d’alerte précoce en cas de catastrophe. Les opérateurs jouent un rôle clé dans la numérisation d’autres secteurs, en utilisant des technologies comme la 5G et le network slicing pour des réseaux spécialisés, par exemple dans les mines avec EthioTel, et dans l’éducation avec des solutions numériques ciblées.
Quels secteurs (santé, éducation, fintech, agriculture, énergie) ont le plus grand potentiel de numérisation en Afrique ?
Cela dépend des priorités des gouvernements. L’agriculture est centrale — la plupart des pays africains dépendent des terres et de l’agriculture pour l’emploi et les exportations. Les services de conseil mobile, les données météorologiques et les solutions d’assurance peuvent améliorer la productivité et la résilience des agriculteurs.
La santé offre aussi des opportunités grâce à la télémédecine, la surveillance mobile de la santé, le suivi de la vaccination et l’amélioration de l’efficacité des services. Par exemple, une université singapourienne a piloté la télémédecine à Kumasi, Ghana, où des médecins ont soutenu les hôpitaux locaux via la 4G pour améliorer les procédures médicales.
L’énergie est un autre défi — des solutions comme les systèmes solaires peuvent améliorer l’accès. Les plateformes mobiles sont centrales pour développer ces secteurs.
Selon vous, comment les start-ups et l’innovation locales peuvent-elles accélérer la transition numérique de l’Afrique ?
Les start-ups sont cruciales. M-Pesa était autrefois une start-up. Elles ont besoin de cadres juridiques clairs définissant droits et obligations, ainsi qu’un environnement favorable pour se développer, incluant infrastructures et hubs reliant aux investisseurs.
Les fonds de défi, accélérateurs, financements à risque et seed funding de GSMA stimulent l’innovation dans les zones sous-desservies. Les hubs soutenus par les opérateurs et les programmes GSMA favorisent l’IA, l’IoT et les solutions analytiques pour les marchés africains, garantissant des solutions par les Africains, pour les Africains, avec le soutien des politiques de startup.
Quelles leçons peut-on tirer d’autres régions pour accélérer le développement numérique de l’Afrique ?
La présence mondiale de GSMA permet le partage d’expériences.
Southeast Asia démontre une forte coordination public-privé et des régulations agiles, accélérant l’adoption des paiements mobiles. Latin America montre des modèles de libéralisation des télécoms et d’investissement en fibre. India illustre les plateformes gouvernementales d’identité numérique et de paiement promouvant l’innovation et l’inclusion.
Une leçon clé est l’importance d’une politique harmonisée. L’Afrique souffre souvent d’approches fragmentées au niveau national. Les politiques numériques doivent refléter la nature transfrontalière du numérique.
Qu’est-ce qui rend le MWC Kigali 2025 unique et comment ce forum favorise-t-il l’innovation et la collaboration numérique en Afrique ?

MWC Kigali est le principal événement africain sur la connectivité, qui se tiendra du 21 au 23 octobre 2025 au Kigali Convention Centre. Les éditions précédentes ont rassemblé plus de 3 400 participants, 230 intervenants et des participants de plus de 90 pays. Pour la troisième année consécutive, l’événement sera ouvert officiellement par Son Excellence Paul Kagame, Président du Rwanda, marquant un engagement politique de haut niveau.
Les thèmes incluent l’IA, la fintech et la connectivité continentale pour faire avancer le numérique en Afrique. L’inclusion numérique reste centrale, mise en avant à travers le programme ministériel — une session sur invitation uniquement pour les décideurs et régulateurs afin de discuter des réformes visant à réduire la fracture numérique. Les sessions porteront sur la transformation numérique, la synergie entre investissements énergétiques et infrastructures numériques, et la gestion du spectre.
Lors du programme ministériel, une task force pour la protection des enfants en ligne sera lancée afin de garantir la sécurité des enfants dans le cadre de la transformation numérique africaine. MWC Kigali favorise la collaboration, l’innovation et une croissance numérique inclusive, avec un engagement à ne laisser personne de côté à l’ère numérique.