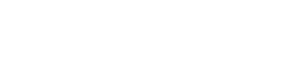Africa at the Crossroads: What the ICJ’s Climate Ruling Means for Our Future
In this analysis, Angela van der Berg emphasizes that the historic ruling by the International Court of Justice (ICJ) legally obliges states to act on climate change. For Africa, a continent with minimal emissions but severe impacts, this decision creates new opportunities to demand climate justice, secure adaptation funding, hold polluters accountable, and advance a just energy transition. By Angela van der Berg*
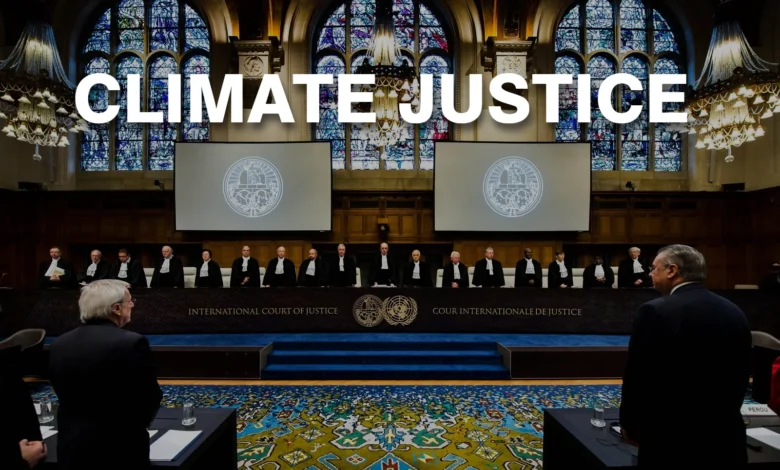
On 23 July 2025, the International Court of Justice (ICJ), made history. It declared that governments are legally obliged to act on climate change. For Africa, which has contributed negligibly to climate change but suffers some of its worst impacts, this opinion could be a game changer.
Binding Climate Obligations
The Court confirmed that under climate change treaties states must do much more than sign papers. They are legally obliged to prepare and implement climate plans known as Nationally Determined Contributions (NDCs) with real ambition and care (paras. 230–254). The Court also made it clear that adaptation (preparing for the climate impacts already here) is not optional but a binding duty, especially to protect vulnerable populations (paras. 255–259).
The Court further affirmed the 1.5°C limit in the Paris Agreement as the primary goal (para. 224). To achieve it, states are legally required to put forward NDCs that, taken together, are capable of keeping the world below that threshold (para. 249). They must act with due diligence and “best efforts” in preparing and carrying out these commitments (paras. 250–254). In other words: governments are legally bound to take ambitious, science-based action to stop runaway warming.
Customary Law: Obligations for All States
The ICJ emphasised that beyond treaties, all countries are bound by customary international law (the unwritten rules that form part of global law) (paras. 271–315). This includes the duty to prevent significant environmental harm, the duty to cooperate in good faith to address climate change, and the obligation to act with precaution and due diligence. This means that even states outside major climate treaties cannot avoid responsibility: every government has legal duties to protect the climate system.
Loss and Damage Becomes a Legal Right
The ICJ reframed loss and damage as a matter of law, not politics. The Court ruled that when obligations are breached, states must provide restitution, compensation, and other forms of reparation (paras. 447–455). As authors have commented, this clarifies that the new Loss and Damage Fund is not about charity but about legal responsibility.
This strengthens Africa’s hand in demanding climate finance and accountability from wealthier nations, and it could also open the way to holding fossil fuel corporations responsible when their activities cause harm (paras. 276–284).
Human Rights: The Missing Children
The ICJ recognised that climate change threatens rights to life, health, food, water, housing, and a clean, healthy, and sustainable environment (paras. 372–393). It also framed climate action as an issue of justice between generations (para. 111).
But children, who make up more than 40% of Africa’s population, were barely mentioned. The Court grouped them only as “vulnerable persons”. This is a missed opportunity, especially for Africa, where children already face hunger, illness, and displacement linked to climate change. African leaders can build on this gap, using instruments like the African Charter on the Rights and Welfare of the Child to push for stronger protection.
Fossil Fuels: A Wake-Up Call
In one of its boldest findings, the ICJ linked fossil fuels directly to state responsibility (paras. 276–284, 315). Governments must regulate companies that produce and burn fossil fuels (para. 284), and even fossil fuel subsidies could amount to internationally wrongful acts if they worsen climate change (paras. 281–282).
This is a wake-up call for African governments pushing new oil and gas projects in Uganda, Mozambique, Namibia, and South Africa. The Court’s opinion signals that the future lies in a just energy transition, not in clinging to fossil fuels
Rights of Nature: The Silence That Speaks
The court was silent on the Rights of Nature. It did not consider whether rivers, forests, or ecosystems can be recognised as rights-holders. For Africa, this matters. Philosophies like Ubuntu stress the deep interconnection between humans, communities, and nature. Recognising rights for rivers or forests could allow them to be defended in court before they are destroyed.
Perhaps the ICJ left this issue open so domestic courts can develop it in line with local values. For Africa, this silence is an invitation to create legal frameworks that protect not just people, but the ecosystems on which they depend.
A Tool for Justice, Not the Final Word
The ICJ’s ruling is not binding, but the international obligations it confirmed under international and customary law, are. The ruling carries enormous moral and legal weight. For Africa, it is a shield to protect vulnerable communities, and a lever to demand accountability from polluters and wealthy states. At the same time, what the Court left unsaid, (about children and nature rights) is just as important. These silences may be a chance for Africa’s own courts, rooted in values like Ubuntu, to take the next step.
La Cour internationale de Justice (CIJ) a marqué l’histoire en déclarant que les gouvernements sont légalement tenus d’agir contre le changement climatique. Pour l’Afrique, qui a contribué de manière négligeable au changement climatique mais en subit certains des effets les plus sévères, cet avis pourrait représenter un tournant.
Obligations climatiques contraignantes
La Cour a confirmé que, dans le cadre des traités sur le climat, les États doivent faire bien plus que signer des accords. Ils sont légalement tenus de préparer et mettre en œuvre des plans climatiques, connus sous le nom de Contributions déterminées au niveau national (CDN), avec ambition et sérieux (paras. 230–254). La Cour a également précisé que l’adaptation (préparer les impacts climatiques déjà présents) n’est pas optionnelle mais constitue un devoir contraignant, notamment pour protéger les populations vulnérables (paras. 255–259).
La Cour a en outre réaffirmé que la limite de 1,5 °C de l’Accord de Paris constitue l’objectif principal (para. 224). Pour l’atteindre, les États sont légalement tenus de présenter des CDN capables, prises ensemble, de maintenir le réchauffement en dessous de ce seuil (para. 249). Ils doivent agir avec diligence et “les meilleurs efforts” dans la préparation et l’exécution de ces engagements (paras. 250–254). En d’autres termes, les gouvernements sont légalement tenus d’adopter des actions ambitieuses et basées sur la science pour stopper le réchauffement incontrôlé.
Droit coutumier : obligations pour tous les États
La CIJ a souligné qu’au-delà des traités, tous les pays sont liés par le droit international coutumier (les règles non écrites qui font partie du droit mondial) (paras. 271–315). Cela inclut le devoir de prévenir les dommages environnementaux significatifs, le devoir de coopérer de bonne foi pour lutter contre le changement climatique et l’obligation d’agir avec précaution et diligence. Ainsi, même les États hors des principaux traités climatiques ne peuvent échapper à leurs responsabilités : chaque gouvernement a des devoirs légaux pour protéger le système climatique.
Perte et dommage : un droit légal
La CIJ a redéfini la notion de perte et dommage comme un enjeu juridique et non politique. La Cour a statué que lorsque les obligations sont violées, les États doivent fournir réparation, compensation et autres formes de restitution (paras. 447–455). Comme l’ont commenté certains auteurs, cela clarifie que le nouveau Fonds pour les pertes et dommages ne relève pas de la charité mais de la responsabilité juridique.
Cette décision renforce la position de l’Afrique pour réclamer un financement climatique et la responsabilisation des pays riches et pourrait également ouvrir la voie à tenir les entreprises fossiles responsables lorsque leurs activités causent des dommages (paras. 276–284).
Droits humains : les enfants oubliés
La CIJ a reconnu que le changement climatique menace les droits à la vie, à la santé, à l’alimentation, à l’eau, au logement et à un environnement propre, sain et durable (paras. 372–393). Elle a également présenté l’action climatique comme une question de justice entre générations (para. 111).
Cependant, les enfants, qui représentent plus de 40 % de la population africaine, ont été à peine mentionnés. La Cour les a regroupés uniquement parmi les “personnes vulnérables”. C’est une occasion manquée, surtout pour l’Afrique, où les enfants subissent déjà la faim, la maladie et le déplacement liés au changement climatique. Les dirigeants africains peuvent combler cette lacune, en utilisant des instruments comme la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant pour renforcer leur protection.
Énergies fossiles : un signal d’alerte
Dans l’une de ses conclusions les plus audacieuses, la CIJ a directement relié les énergies fossiles à la responsabilité des États (paras. 276–284, 315). Les gouvernements doivent réguler les entreprises qui produisent et brûlent des combustibles fossiles (para. 284), et même les subventions aux combustibles fossiles pourraient constituer des actes internationalement illicites si elles aggravent le changement climatique (paras. 281–282).
C’est un signal fort pour les gouvernements africains qui développent de nouveaux projets pétroliers et gaziers en Ouganda, au Mozambique, en Namibie et en Afrique du Sud. L’avis de la Cour indique que l’avenir repose sur une transition énergétique juste, et non sur la dépendance aux combustibles fossiles.
Droits de la nature : le silence qui parle
La Cour est restée silencieuse sur les droits de la nature. Elle n’a pas considéré si les rivières, forêts ou écosystèmes pouvaient être reconnus comme titulaires de droits. Pour l’Afrique, cela a de l’importance. Des philosophies comme l’Ubuntu soulignent l’interconnexion profonde entre les humains, les communautés et la nature. Reconnaître des droits pour les rivières ou forêts pourrait permettre de les défendre devant les tribunaux avant qu’elles ne soient détruites.
Peut-être la CIJ a-t-elle laissé cette question ouverte pour que les tribunaux nationaux puissent la développer selon les valeurs locales. Pour l’Afrique, ce silence est une invitation à créer des cadres juridiques qui protègent non seulement les populations mais aussi les écosystèmes dont elles dépendent.
Un outil pour la justice et non la dernière parole
La décision de la CIJ n’est pas contraignante, mais les obligations internationales qu’elle confirme au titre du droit international et coutumier le sont. Cette décision a un poids moral et juridique considérable. Pour l’Afrique, elle constitue un bouclier pour protéger les communautés vulnérables et un levier pour exiger la responsabilité des pollueurs et des États riches. Dans le même temps, ce que la Cour n’a pas dit, (concernant les enfants et les droits de la nature) est tout aussi important. Ces silences peuvent offrir à la justice africaine, enracinée dans des valeurs comme l’Ubuntu, l’opportunité de franchir la prochaine étape.