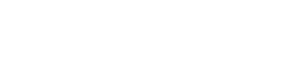Quand l’Afrique ouvre ses campus au monde
De Dakar à Kigali, les universités africaines accélèrent leur ouverture internationale : programmes bilingues, échanges d’étudiants et chercheurs, centres de recherche partagés et accords de reconnaissance des diplômes. À l’heure où la mobilité étudiante mondiale dépasse les 6,8 millions, les établissements du continent cherchent à capter une part de cette dynamique tout en redéfinissant les règles du partenariat.

Par Bylkiss Mentari
Les chiffres rendent compte d’un mouvement tangible. Selon les dernières estimations mondiales, le nombre d’étudiants internationaux a atteint près de 6,9 millions en 2023, une trajectoire à la hausse qui crée des opportunités pour les universités africaines désireuses d’attirer talents et capitaux académiques.
Parallèlement, la mobilité régionale a fortement augmenté : entre 1998 et 2021, le nombre d’étudiants mobiles en provenance d’Afrique subsaharienne est passé d’environ 164 000 à plus de 441 000. Ces flux montrent non seulement des départs vers l’étranger, mais aussi un potentiel d’accueil croissant à l’intérieur du continent.
Programmes bilingues et échanges académiques : un atout différenciant
De plus en plus d’universités africaines développent des cursus bilingues (français-anglais) et des doubles diplômes pour répondre au marché global du travail et faciliter la mobilité. L’implantation de campus internationaux comme Carnegie Mellon University Africa — qui compte, à l’échelle du campus africain, plusieurs centaines d’étudiants et des alumni issus d’une vingtaine de nationalités — illustre le modèle « campus global » implanté en Afrique, mêlant formation de haut niveau et insertion professionnelle. Ces campus attirent des partenariats industriels et des programmes d’échange qui enrichissent l’écosystème local.
Collaborations scientifiques transcontinentales : fabriquer de l’excellence en réseau
Les alliances régionales jouent un rôle clé : l’African Research Universities Alliance (ARUA) regroupe des universités de recherche pour mutualiser compétences et infrastructures, et multiplie les accords avec des partenaires européens et britanniques pour monter des centres d’excellence. Comme l’a rappelé Ernest Aryeetey, secrétaire général d’ARUA, « les problèmes transnationaux exigent des solutions transnationales » — plaidoyer pour des coopérations fondées sur le respect mutuel et l’équité scientifique. Ces initiatives facilitent l’accès à des financements, permettent la co-supervision de doctorats et renforcent la visibilité internationale des équipes africaines.
Reconnaissance des diplômes : un chantier essentiel
L’ouverture ne vaut que si les titres produits sont reconnus. Plusieurs réseaux africains et internationaux travaillent à harmoniser les référentiels et à promouvoir la reconnaissance mutuelle des diplômes. La création de chartes et cadres continentaux — comme la « Africa Research Charter » portée par les acteurs universitaires — vise à centrer la collaboration sur des priorités africaines tout en facilitant la comparabilité des formations. Une reconnaissance plus fluide est cruciale pour attirer des étudiants étrangers et pour permettre aux diplômés africains de circuler professionnellement.
Asymétries dans les partenariats et barrières administratives
L’ouverture soulève des défis : inégalités entre universités (capacités d’accueil, financement, attractivité), risques d’asymétrie dans les partenariats (recherche extractive, mise à l’écart des priorités locales) et barrières administratives pour la mobilité des étudiants et du personnel. Pour que l’ouverture profite réellement au développement, il faut des partenariats « gagnant-gagnant », des mécanismes de financement pérennes et une gouvernance qui protège les agendas scientifiques africains.
Une offre académique qui s’enrichit mais…
L’Afrique dispose d’atouts — jeunesse, défis locaux pertinents pour la recherche mondiale, et une offre académique qui s’enrichit — pour devenir à la fois émetteur et récepteur d’étudiants et de chercheurs. Mais la transition requiert investissement en infrastructures, soutien aux carrières académiques et politiques de reconnaissance diplomatique adaptées. Si la tendance se confirme, les campus africains pourraient bientôt compter parmi les destinations de choix pour une génération mondiale d’étudiants à la recherche de formations ancrées dans la réalité du XXIᵉ siècle.