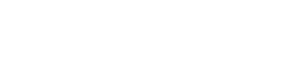Fermer pour mieux rouvrir ? Quand l’autonomie économique devient une nécessité
Cart’Afrik publie aujourd’hui une tribune de Kaïs Mabrouk, PhD, chercheur et expert en éducation et économie, qui interroge le dogme du libre-échange. À travers des exemples allant de la Russie à l’Algérie, en passant par la Corée du Sud, il défend l’idée que fermer temporairement ses frontières peut être une étape nécessaire pour bâtir une véritable autonomie économique, avant de rouvrir avec plus de force et de résilience. Par Kaïs Mabrouk*
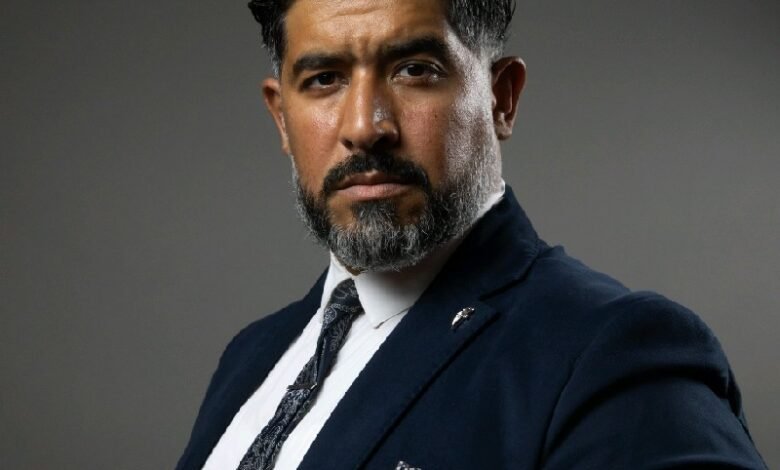
La croyance dominante veut que l’ouverture commerciale soit toujours bénéfique, que le libre-échange soit l’unique route vers la prospérité. Pourtant, les faits et l’histoire racontent une autre version. Ha-Joon Chang (Corée du Sud), dans Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism (2008), démonte méthodiquement cette idée reçue : les nations aujourd’hui développées n’ont pas grandi dans un bain de libre-échange, mais derrière des murs protecteurs, le temps de bâtir leur industrie. Ce n’est qu’après avoir consolidé leurs forces qu’elles ont prôné l’ouverture… tout en dissuadant les autres de suivre la même voie.
Dani Rodrik, économiste de Harvard, va dans le même sens : un pays qui veut se redresser doit parfois résister à la tentation de la libéralisation immédiate. Fermer, temporairement, ses frontières à certaines importations peut offrir l’espace nécessaire pour réindustrialiser, protéger des secteurs stratégiques, et éviter que le marché local ne devienne un simple débouché pour la production étrangère. La réouverture doit ensuite être progressive, ciblée, guidée par une stratégie nationale claire.
La Volga
Ces thèses, je les ai lues. Mais hier, elles ont pris un visage humain. Celui de Dimitri et Maria, deux collègues universitaires russes venus passer des vacances à Hammamet. Opposés à toute violence, profondément respectueux de la vie humaine, viscéralement internationaux, ils m’ont raconté comment les sanctions internationales, imposées après la guerre en Ukraine, ont bouleversé leur quotidien économique.
Dans leurs rayons, les produits français, le textile italien, les voitures allemandes ont disparu. À la place, des biens produits localement, parfois moins sophistiqués au début, mais rapidement améliorés. Maria, toujours élégamment vêtue et passionnée de mode, m’a confié : « Je n’aurais jamais cru trouver du plaisir et de la qualité dans des vêtements fabriqués en Russie. J’ai toujours acheté et porté de l’étranger. Aujourd’hui, je me sens mieux habillée avec nos propres textiles. ». Des usines ont ouvert, créant du plein emploi. L’agriculture, longtemps délaissée au profit d’importations plus faciles, a été relancée : il a fallu « réarmer » les agriculteurs, remettre les fermes en marche. Dimitri, lui, souriait en avouant : « Je n’avais jamais goûté à une tomate russe. À Saint-Pétersbourg, ce sont toujours des produits importés qui envahissent nos mets et nos plats. ». Résultat : un tissu productif revivifié, une main-d’œuvre réengagée, une économie moins dépendante.
EL Mordjene effect
Cet exemple m’a rappelé des conversations avec mon ami Nassim, en Algérie. Lorsqu’Alger a drastiquement limité certaines importations, il a vu de ses propres yeux des secteurs reprendre vie, de la production alimentaire à la transformation locale. Certes, le consommateur doit s’adapter, accepter que tout ne vienne pas d’ailleurs. Mais les bénéfices tangibles : emplois, compétences, résilience et pépites (EL Mordjene).
En Algérie aussi, on expérimente la force d’une régulation des importations pour relancer l’économie locale. En septembre 2023, le gouvernement a mis en place le Conseil supérieur de régulation des importations, chargé de réorienter les fonds vers la production nationale et de stimuler les industries locales. Quelques mois plus tard, en mai 2024, le ministre du Commerce, précisait que l’objectif n’était pas de geler les importations, mais de les rationaliser : en 2023, la facture d’importation est passée de près de 60 milliards USD à 44 milliards USD, favorisant transformation locale et création d’emplois. Cette stratégie a été confirmée en juin 2024 lors de la 55ᵉ Foire internationale d’Alger, où le ministre rappelait : « Ce que nous produisons, nous ne l’importerons pas », citant l’exemple du blé, dont l’autosuffisance permet d’économiser 1,2 milliard USD.
Miracle de la rivière Han
La Corée du Sud, que l’on cite aujourd’hui comme un modèle de réussite économique, n’est pas née dans un bain de libre-échange. Sortie exsangue de la guerre dans les années 1950, elle a bâti sa renaissance derrière un rempart de protectionnisme sélectif. L’État, stratège et intraitable, a choisi ses champions industriels, les chaebols, et les a couvés, protégés des géants étrangers, le temps qu’ils grandissent et apprennent à conquérir. Les frontières restaient entrouvertes, mais l’accès au marché local se gagnait au mérite et selon les besoins du plan national. Ce n’est qu’une fois l’armature industrielle solidement forgée que Séoul a levé le bouclier, lançant ses navires, ses voitures et ses écrans sur les mers du commerce mondial. Le “Miracle de la rivière Han” n’a pas été le fruit d’un marché livré à lui-même, mais celui d’un État qui a su fermer pour mieux ouvrir, retenir pour mieux propulser.
Se vêtir et se nourrir de ce que l’on produit
On dira que ce n’est pas facile, que le « nouveau monde libre » exige que l’on achète chez ceux qui produisent… chez eux. Mais peut-être faut-il inverser la question : comment espérer se relever si l’on ne produit plus rien chez soi ?
L’autonomie n’est pas synonyme d’isolement. C’est un choix stratégique, parfois imposé par les circonstances, mais qui peut transformer une économie. Fermer la porte, ce n’est pas se couper du monde. C’est se donner le temps d’apprendre à tenir debout… et à rouvrir en position de force.
En outre, Carthage est à reconstruire.
*Kaïs Mabrouk, PhD, est chercheur en économie et spécialiste des politiques éducatives. Il analyse les liens entre développement, souveraineté économique et dynamiques sociales en Afrique et ailleurs.