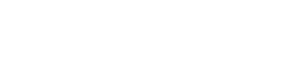Idrissa Diabira : Industrialiser l’Afrique ou rester assis par terre !
Dans cette analyse, Idrissa Diabira, fondateur de Sherpa – Driving to the Next Africa et ancien directeur général de l’ADEPME, défend une industrialisation africaine enracinée dans les imaginaires culturels du continent, capable d’allier ambition économique, dignité sociale et souveraineté stratégique. Par Idrissa Diabira*

Moins de 5 % des actifs africains occupent un emploi formel. Chaque année, 20 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail pour à peine 3 millions d’emplois formels créés. Ce déficit alimente précarité, exil économique et instabilités. Ce n’est pas qu’un problème économique : c’est un enjeu de souveraineté collective et de dignité sociale. Sans industrialisation, pas d’emplois massifs, pas d’autonomie stratégique, pas de valeur ajoutée captée localement.
Pourtant, les nations qui ont bâti leur puissance industrielle l’ont toujours fait sur la base d’un imaginaire collectif fort, donnant sens et légitimité à l’effort productif. Aux États-Unis, le Small Business Act de 1953 prolonge le mythe du self-made man, l’entrepreneur libre conquérant son destin. En protégeant les PME, il a consolidé un idéal où la réussite économique est presque un devoir moral.
“Ce n’est pas qu’un problème économique : c’est un enjeu de souveraineté collective et de dignité sociale”
Au Japon, après l’ère Meiji puis la reconstruction, l’industrialisation s’est faite sous la maxime 和魂洋才 (wakon yōsai) — « âme japonaise, techniques occidentales », absorbant le savoir-faire mondial sans renier l’esprit collectif : discipline, respect hiérarchique, honneur du travail bien fait. Cet imaginaire a aligné sacrifices individuels et projet industriel national.
En Malaisie, la New Economic Policy des années 1980, née des fractures interethniques, a forgé un ethos mêlant valeurs islamiques (solidarité, probité), héritage confucéen (discipline, hiérarchie) et fierté malaise. Cet imaginaire composite a permis la montée en gamme industrielle et les stratégies de contenu local.
Pourquoi l’Afrique peine-t-elle à créer cet élan ?
Parce que, depuis les indépendances, nos trajectoires restent rivées à des modèles importés, laissant nos économies extraverties et sans socle industriel endogène. Dans les années 60-70, l’Afrique a copié le modèle sud-américain : des industries d’État bancales, vite écroulées au premier choc. Puis les programmes d’ajustement structurel des années 1980-90 ont libéralisé à marche forcée, achevant ce qui restait. Résultat : l’Afrique s’est désindustrialisée avant même d’avoir véritablement industrialisé.
Cheikh Anta Diop rappelait qu’aucune renaissance n’est possible sans ancrage culturel. Felwine Sarr nous exhorte à « nous ressaisir de notre imaginaire », à inventer nos propres horizons de sens au lieu d’absorber passivement ceux venus d’ailleurs. Industrialiser, c’est précisément cela : faire de la production une expression de notre ethos, non une imitation servile.
Via nos PME et notre ethos africain
Il faut repenser le paradigme de la PME : distinguer micro-entreprises de survie, PME intermédiaires à consolider et PME « transformationnelles » à intégrer dans des politiques ambitieuses — zones industrielles, clusters, contenu local. Mais surtout, il faut bâtir un imaginaire collectif africain qui valorise la création, l’innovation et la prise de risque, au-delà des logiques de rente. Cet ethos peut puiser dans nos propres ressources : réseaux jula, solidarité haoussa, entrepreneuriat mouride, pour devenir le socle culturel de véritables Small Business Acts africains.
“Je plaide pour un Small Business Act africain, non comme un copier-coller, mais comme une architecture hybride articulant institutions visibles et institutions invisibles”
Je plaide pour un Small Business Act africain, non comme un copier-coller, mais comme une architecture hybride articulant institutions visibles (agences, financements, zones spéciales) et institutions invisibles (normes sociales, confiance, imaginaires partagés). Comme les États-Unis ont sanctuarisé le self-made man, le Japon marié techniques modernes et âme locale, la Malaisie arrimé son industrie à son identité, l’Afrique doit inventer son propre récit productif.
Industrialiser l’Afrique, ce n’est pas seulement ériger des usines. C’est affirmer notre souveraineté économique et culturelle, créer des emplois formels pour des millions de jeunes et inscrire notre continent autrement qu’à la marge des chaînes de valeur mondiales.
Joseph Ki-Zerbo l’exprimait d’une formule saisissante :
« Celui qui ne s’assoit pas sur sa natte s’assoit par terre. »
Si nous ne bâtissons pas notre industrialisation sur nos imaginaires, nos solidarités et notre ethos africain, nous resterons assis par terre, dépendants, incapables de capter la valeur que nous n’aurons pas su créer.
*Idrissa Diabira est Praticien-chercheur, CEO SherpAfrica, ex-DG ADEPME Sénégal (1ʳᵉ CEDEAO, 3ᵉ Afrique ITC), Team Leader ROGEAP.